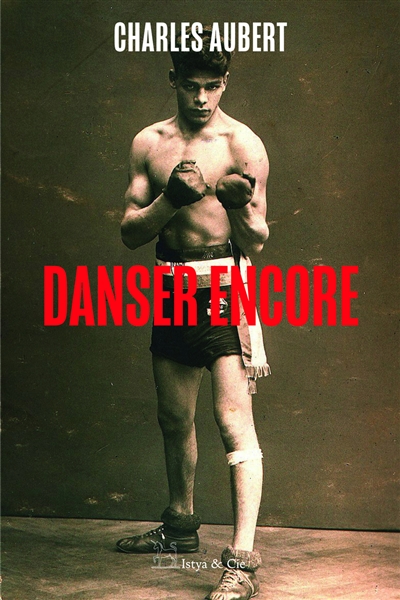Le droit romain à l’origine de la légitimité politique occidentale
ÉCLAIRAGES : Chaque mois, un sujet d’actualité scientifique éclairé par une chercheuse ou un chercheur du Collège de France. Auteur : François Waquet
Comment les monarques européens ont-ils légitimé leur pouvoir pendant des siècles ? Au cœur de cette question se trouve un héritage souvent méconnu, mais décisif, celui du droit romain. Bien après la chute de l’Empire romain, cette tradition juridique a servi de socle intellectuel et institutionnel aux monarchies européennes. Elle a fourni des outils de gouvernement et une rhétorique de légitimation qui ont traversé les âges jusqu’à constituer les fondements de notre système politique contemporain.
Dans la tradition occidentale, la souveraineté n’a jamais reposé exclusivement sur la force ou sur une transcendance divine. Elle s’est aussi construite par le droit. À cet égard, le modèle romain s’impose comme l’un des plus puissants instruments de légitimation, en particulier à travers la lex regia. Cette loi d’investiture impériale fait aujourd’hui encore l’objet de controverses. Elle est connue grâce à des sources juridiques et littéraires, mais aussi par le fragment d’une remarquable inscription concernant l’avènement de Vespasien, en 69 apr. J.-C., et nommée par les chercheurs lex de imperio Vespasiani, « loi sur le pouvoir de Vespasien ». L’inscription est conservée au musée du Capitole, à Rome. Il s’agit du seul exemplaire d’une loi régulièrement renouvelée pour chaque empereur – une loi que Cola di Rienzo, notaire et homme politique italien, a réactivée dans une perspective explicitement politique au XIVe siècle. L’historien du droit François Waquet explique : « La lex regia est un texte juridique qui énumère un certain nombre de compétences dévolues à l’empereur, mais le pouvoir reste conféré au prince par une décision du peuple ». Ainsi, le rôle de l’empereur ne se trouve fondé ni par l’hérédité ni par la volonté divine, mais par un acte collectif et juridique. Ce modèle romain, centré sur l’investiture du prince par le peuple, repose sur une logique de délégation volontaire et non de transmission surnaturelle.
Ce geste fondamental permet d’ancrer la souveraineté dans un acte rationnel et formalisé. Comme le résume le chercheur, la lex regiafournit un « modèle de légitimation du pouvoir complètement humain et de droit positif », ce qui en fait une alternative essentielle à la légitimité de droit divin. En dépit des évolutions politiques de l’Empire, en particulier de la reconnaissance, au IVe siècle, du christianisme comme religion officielle, le souvenir de la lex regia continue d’être réactivé. Après la chute de Rome, ce modèle offre une alternative conceptuelle à la souveraineté de droit divin, dominante dans les monarchies chrétiennes du Moyen Âge et de l’Époque moderne, et s’accompagne de procédés rhétoriques qui fondent l’autorité du monarque.
La rhétorique du droit romain
Ce modèle juridique de légitimation ne s’est pas effacé avec la disparition progressive des institutions républicaines romaines persistant au sein même de l’Empire. Bien au contraire, selon François Waquet, l’autorité du prince sous l’Empire tardif ne s’est pas construite uniquement par la contrainte, mais par l’usage subtil d’une langue persuasive. L’étude des constitutions impériales des IVeet Ve siècles, des actes normatifs émis par l’empereur ayant force de loi, montre les procédés rhétoriques à l’œuvre dans ces textes. L’empereur, bien que bénéficiant de puissantes prérogatives, recourt à une forme de persuasion discursive. « L’autorité, nous pouvons la définir comme le fait d’être obéi sans contrainte. L’empereur use de rhétorique pour susciter l’obéissance », explique le chercheur. Cette démarche scientifique renverse la lecture traditionnelle des sources de l’Antiquité tardive comme simples énoncés autoritaires, en soulignant leur dimension argumentative. Dès lors, la législation impériale tardive apparaît comme un discours façonné pour convaincre, et non simplement pour imposer.
Dans le genre de discours délibératifs que les Anciens appelaient « suasoires », il est fréquent que le locuteur s’érige lui-même en exemple. Ainsi, dans certaines constitutions, l’empereur affirme que la loi est si juste qu’il s’y soumet lui-même. Ce type de construction n’est pas anodin, il s’inscrit dans une culture de l’exemplarité et de la persuasion, héritée des traditions oratoires gréco-romaines, et permet de « rendre crédible un ordre légal sans recourir à la contrainte ». Cette rhétorique du droit répond également à un élargissement de la citoyenneté. Depuis l’édit de Caracalla en 212, tous les hommes libres de l’Empire sont citoyens. Les lois générales qui s’adressent désormais à l’ensemble du corps civique doivent adapter leur style à une pluralité de publics. « Il existe une manière de parler qu’il faut adapter, justifiant ainsi une sophistication croissante du discours impérial », note François Waquet. Autant de procédés qui nourriront le pouvoir politique à l’avènement des monarchies européennes dès le haut Moyen Âge.
Une matrice juridique pour les monarchies européennes
L’intérêt de cet héritage ne s’est pas limité à l’Empire romain ou à ses prolongements byzantins. Loin de s’éteindre avec la chute de Rome, le droit romain connaît une réactivation décisive en Occident à partir du XIe siècle, notamment avec la redécouverte du Corpus juris civilis à Bologne. Ce retour en force du droit antique irrigue l’ensemble des constructions juridiques européennes. François Waquet souligne que cette réception s’opère « aussi bien dans le Saint-Empire romain germanique que dans les monarchies occidentales, où le droit romain est utilisé pour justifier des positions parfois parfaitement contraires ». Le droit romain, et en particulier la figure du monarque législateur, a servi de modèle aux monarchies européennes dès le Moyen Âge. François Waquet insiste : « cette référence n’est pas réservée au Saint-Empire romain germanique, les autres royaumes d’Europe se sentaient tout aussi légitimes pour revendiquer l’héritage romain ». En France, en Espagne et même en Angleterre, des traditions politiques et juridiques distinctes ont pourtant trouvé dans le droit romain une ressource commune pour penser la souveraineté.
Ce paradoxe apparent s’explique par la plasticité que la tradition romaine tient précisément de sa capacité à penser le pouvoir comme une institution humaine, formalisée par des règles, des procédures, et une langue. Cette rationalisation de la souveraineté en fait un outil privilégié pour les penseurs du droit naturel, qui y puisent un modèle de contractualisation politique en rupture avec le théologico-politique. Le droit romain offre un lexique et une structure d’argumentation que les souverains, juristes et théologiens adaptent à des contextes très divers. Il permet, par exemple, au pape comme à l’empereur germanique de revendiquer une souveraineté universelle, en réutilisant les formes du droit impérial. Cette polysémie n’empêche pas la circulation des modèles : « le pape a imité l’empereur romain, jusqu’à exercer une juridiction d’appel dans les affaires judiciaires », note l’historien, soulignant ainsi le transfert de techniques et de postures.
Le droit romain redécouvert inspire les tenants du contrat social, en montrant que « la communauté politique peut naître d’une association d’hommes libres et égaux ». En ce sens, le modèle romain, tout en étant marqué par son contexte antique, annonce certaines formes de pensée constitutionnelle de l’Époque moderne. Cette matrice, loin d’être obsolète, continue de structurer la pensée politique occidentale, jusque dans ses formes les plus contemporaines.
*François Waquet est chercheur en histoire du droit romain sur la chaire Droit, culture et société de la Rome antique du Pr Dario Mantovani.